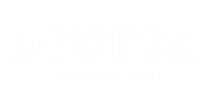Chez les Bédouins, le café peut aller jusqu’à être considéré comme un code d’honneur. Les Bédouins sont un peuple nomade arabe, qui était à l’origine installé exclusivement dans des régions désertiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Aujourd’hui, plus sédentarisé, ce peuple accorde une importance particulière au café. Souvent préparée de manière traditionnelle, cette boisson détient un rôle clé dans l’hospitalité des invités : c’est un rituel social. Le café est servi dans une cafetière traditionnelle appelée dallah.
Trois étapes sont alors respectées : Finjan Al-Haif (la tasse du maître de maison), Finjan Al-Dhaif (la tasse de l’invité) et Finjan Al-Saif (la tasse de l’épée). La première, la tasse du maître de maison, consiste en la dégustation du café par le propriétaire des lieux. Cela permet de s’assurer de la qualité du café, qui est primordiale, car elle transmet les valeurs respectueuses de l’hôte. Un café peu goûteux pourrait être perçu comme un manque d’attention aux invités, ce qui pourrait potentiellement nuire à l’image de celui qui reçoit. Ensuite, la tasse est offerte à l’invité, cela reflète le bon accueil de l’hôte. Le propriétaire remplit la tasse plusieurs fois, c’est ensuite à l’invité de lui indiquer qu’il en a suffisamment bu. Si l’invité en consomme une grande quantité, les Bédouins estiment qu’il est satisfait de son accueil. Enfin, ce rituel autour du café se termine par Finjan Al-Saif, la tasse de l’épée. Elle symbolise un engagement réciproque de protection entre l’hôte et son invité. Une alliance se consolide. Par exemple, le café vient assurer des promesses de sécurité mutuelle, cela est semblable à un “pacte”. Parfois un autre pilier est évoqué, nommé : Finjan Al-Khashm, on l’appelle en français la “tasse du nez”. Il est dit qu’elle est consommée par une personne de haut rang parmi les hôtes, pour être ensuite partagée aux invités. Cette étape n’est pas forcément récurrente dans la préparation du café, certains disent qu’elle est plutôt réalisée durant de grandes cérémonies.
Chez les Bédouins, le café n’est pas une simple boisson à base de graines de caféiers. Il s'agit d'un véritable devoir qui reflète leurs principes honorables. Au-delà de la simple consommation, le café bédouin sert également de levier dans le maintien des liens sociaux. Lorsqu’un hôte bédouin offre du café à un invité, il intègre de manière symbolique ce dernier dans son cercle social. Les gestes que nécessite le service du café, comme par exemple le secouement de la tasse, expriment une communication non verbale chargée de sens. Dès lors qu’un invité attendu entre dans la maison du propriétaire, il se voit protégé par son hôte bédouin. La solidarité de la communauté bédouine est par conséquent mise en avant par leur grande hospitalité, inhérente à leur culture. Le café bédouin occupe une place cruciale dans leur quotidien, il sert à la fois d’instrument dans les processus de réconciliation (sulha en arabe), de négociation et de célébration.